75 Ans de JT : L'Ancien Roi de l’Info Peut-il Encore Régner ? (Level C1-C2)
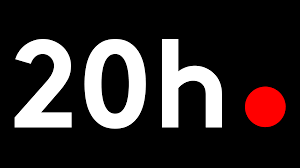
Voici quelques expressions et mots de l'article à connaître qui vous permettront d'enrichir votre vocabulaire :
Pendant des décennies : For decades
Toute génération confondue : Across all generations
À 20h tapamtes: At exactly
ni générique : no opening theme,
une montgolfière. : a hot air balloon
a pris feu : caught fire
casi inexistante : almost non-existent
Dans les années 1950 : In the 1950’s
reprend le flambeau : took over
instaure une formule inédite : and introduced a new concept
Le passage à la couleur : the switch to color
une affaire d’hommes : a man’s world
ouvre la voie : paving the way
atteint des sommets d’audience. : reached its peak
par excellence : the go-to
entre en concurrence : began facing direct competition
néanmoins : nevertheless
De plus en plus: Increasingly
n’a peut-être plus le poids : no longer carry the same weight
Impossible de le dire : That remains to be seen.
Le Journal Télévisé en France — que l’on appelle couramment « le 20h » ou simplement « le JT » — a longtemps été une véritable institution. Pendant des décennies, il a rythmé la vie des Français. Toute génération confondue, le JT était le rendez-vous du soir à ne pas manquer. À 20h tapantes, les familles se retrouvaient devant l’écran pour voir "ce qui se passe dans le monde", et attendaient avec une curiosité amusée la météo de fin d’émission.
Cette histoire commence le 29 juin 1949. Ce soir-là, Pierre Sabbagh entre dans l’histoire en présentant le tout premier journal télévisé de la télévision française. D’une durée de 15 minutes, ce bulletin d’information est diffusé en direct sur la RTF (Radiodiffusion-télévision française), et ne comporte encore ni générique, ni décor, ni prompteur. Le présentateur n’apparaît pas à l’écran : il commente, en voix off, des images filmées, parfois muettes, venues d’agences comme Gaumont Actualités. Le premier sujet ? Un reportage de photos de Paris prises depuis une montgolfière. Mais le ballon a fini par heurté un arbre, s’est écrasé, a pris feu, la gendarmerie est arrivée pour arrêter les auteurs de ces dégâts qui se justifiaient en parlant de reportage pour la télévision, casi inexistante à cette époque, les gendarmes se sont gentiement moqués d’eux !
Dans les années 1950, la télévision française se développe lentement mais sûrement. Ce n’est qu’en 1954 que les téléspectateurs voient pour la première fois un présentateur apparaître à l’image. Il s’agit de Georges de Caunes, qui incarne cette nouvelle proximité entre l’écran et le public. L’année suivante, Roger Debouzy reprend le flambeau. À mesure que la télévision se démocratise, le journal évolue : en 1959, Pierre Sabbagh, revenu à la direction du service d’information, instaure une formule inédite — un JT présenté chaque soir par un même journaliste, dans un décor fixe, avec un ton plus incarné.
Le format s’élargit et gagne en qualité. Le passage à la couleur, en 1967, marque un tournant dans l’esthétique télévisuelle. Le JT s’installe définitivement comme un pilier du paysage audiovisuel français. Les grandes chaînes nationales — TF1, Antenne 2 (devenue France 2), puis France 3 — développent chacune leur propre JT. On y commente les événements majeurs, on y interviewe les hommes politiques, on y rend hommage aux disparus.
Mais le journal télévisé n’est pas qu’une affaire d’hommes. En 1976,Hélène Vida devient la première femme à présenter un JT en France. Une présence féminine qui ouvre la voie à d’autres figures marquantes comme Christine Ockrent, Claire Chazal ou encore Anne-Sophie Lapix, qui marqueront les décennies suivantes par leur style et leur professionnalisme. Le JT devient aussi un espace de représentation, reflet de l’évolution de la société.
Pendant les années 1980 et 1990, le JT atteint des sommets d’audience. Le 20 Heures de TF1, notamment sous la direction de Patrick Poivre d’Arvor, rassemble régulièrement plus de 10 millions de téléspectateurs. Il est alors le média de référence, la source d’information par excellence pour une majorité de Français.
Mais le monde change. À partir des années 2010, la télévision entre en concurrence directe avec internet, les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2025, le JT de France 2 rassemble en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs, soit environ 20 % de part d’audience ; celui de TF1 garde la tête avec 5,2 millions de fidèles, mais ces scores sont en baisse par rapport aux décennies précédentes. Les journaux régionaux de France 3 — Le 19/20 — conservent néanmoins un public fidèle, avec plus de 2 millions de spectateurs chaque soir.
En effet, de plus en plus de Français préfèrent consulter les actualités autrement : sur leur téléphone, en écoutant un podcast, ou en regardant un youtubeur spécialisé dans l’analyse politique ou les faits divers. L’information devient mobile, fragmentée, immédiate. Elle ne suit plus forcément l’ordre classique d’un journal structuré et hiérarchisé.
Le JT n’a peut-être plus le poids qu’il avait autrefois, mais il reste un repère pour de nombreux téléspectateurs notamment pour une population plus âgée. Face à la concurrence du numérique, il devra sans doute se réinventer. Sera-t-il encore là dans dix ou vingt ans ? Impossible de le dire. Une chose est sûre : son histoire reste une page essentielle de la télévision française.
TRADUCTION :
5 Years of the French TV News: Can the Former King of Information Still Reign?
The Journal Télévisé in France—commonly called "le 20 Heures" or simply "le JT"—was, for a long time, a true national institution. For decades, it shaped the rhythm of French daily life. Across all generations, the JT was the evening appointment not to be missed. At exactly 8 p.m., families would gather around the television to find out “what was happening in the world,” often looking forward, with amused curiosity, to the weather forecast that closed each broadcast.
This story began on June 29, 1949. That evening, Pierre Sabbagh made history by presenting the very first television news bulletin in France. Lasting 15 minutes, it aired live on RTF (Radiodiffusion-Télévision Française) and had no opening theme, no set, and no teleprompter. The presenter didn’t appear on screen: he commented off-camera on footage—often silent—provided by agencies like Gaumont Actualités. The first report? A series of photos of Paris taken from a hot air balloon. But things didn’t go as planned—the balloon hit a tree, crashed, caught fire, and the police had to intervene. When the reporters explained they were filming for television—a medium almost non-existent at the time—the gendarmes gently laughed it off.
In the 1950s, French television progressed slowly but steadily. It wasn’t until 1954 that viewers saw a news anchor on screen for the first time: Georges de Caunes, who embodied a new kind of closeness between broadcaster and audience. A year later, Roger Debouzy took over. As television became more widespread, the format evolved. In 1959, Sabbagh returned to lead the news division and introduced a new concept: one journalist presenting the news each evening, with a fixed set and a more personal tone.
The format expanded and improved in quality. The switch to color in 1967 marked a turning point in TV aesthetics. The JT firmly established itself as a cornerstone of French audiovisual culture. National channels—TF1, Antenne 2 (now France 2), and France 3—developed their own evening news programs, which became the stage for major events, political interviews, and national tributes.
But the JT wasn’t just a man’s world. In 1976, Hélène Vida became the first woman to present a TV news bulletin in France, paving the way for influential female journalists like Christine Ockrent, Claire Chazal, and Anne-Sophie Lapix, who would go on to shape the face of French news for decades with their distinct voices and professionalism. The JT became a space for representation, reflecting the changing French society.
During the 1980s and 1990s, the JT reached its peak. TF1’s 8 p.m. news, especially under Patrick Poivre d’Arvor, regularly drew over 10 million viewers, making it the go-to news source for a vast majority of French households.
But times have changed. From the 2010s onward, television began facing direct competition from the internet, social media, and digital platforms. Today, the numbers tell the story. In 2025, France 2’s evening news draws an average of 3.8 million viewers, about 20% of audience share, while TF1 maintains the lead with 5.2 million, though these numbers have dropped compared to earlier decades. Regional news programs on France 3 (Le 19/20) still attract over 2 million viewers daily.
Increasingly, people in France get their news in other ways: on their phones, through podcasts, or from YouTubers specializing in political commentary or current events. Information is now mobile, fragmented, and immediate. It no longer follows the structured, linear format of traditional television news.
The JT may no longer carry the same weight it once did, but it remains a cultural reference point—especially for older generations. In the face of digital competition, it will likely need to reinvent itself. Will it still be around in ten or twenty years? That remains to be seen. But one thing is certain: its legacy is a defining chapter in the history of French television.




